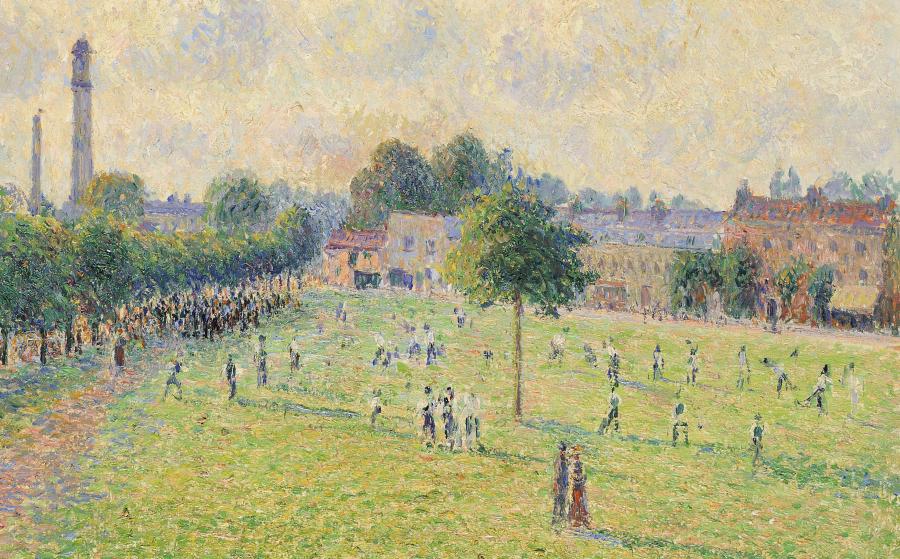En 2011, les acquisitions d'artistes lyonnais du XIXe siècle sont à l'honneur au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Des célébrissimes Hippolyte Flandrin et Victor Orsel à des artistes moins connus comme Joseph Guichard, toute la richesse artistique est représentée. Le buste sculpté de Clémence Sophie de Sermézy, qui fut une élève de Joseph Chinard, apporte une note délicate pour compléter les oeuvres au sujet religieux.
Extraits Audioguide :
. L’acquisition des trois œuvres de Pierre Soulages
. À propos de Peinture 181 x 244 cm, 25 février 2009 : Le choix du noir, par Pierre Soulages
Pierre Soulages, Brou de noix sur papier 60,5 x 65,5 cm, 1947
Les premières œuvres de Pierre Soulages, réalisées entre 1947 et 1949, sont exécutées au brou de noix sur papier. Cette matière inhabituelle, traditionnellement utilisée par les artisans plutôt que par les peintres, est déjà le signe d’une mise en cause des procédés traditionnels de la peinture. La forme remplit l’espace « en se livrant d’un seul coup de manière abrupte » ; monolithique et indivisible, elle est non-descriptive. La couleur sombre, le contraste évident entre les traces et le fond donnent le sentiment d’une peinture qui, déjà, s’impose sans compromis et fait preuve d’une grande autorité plastique. Aujourd’hui presque toutes les peintures sur papier de cette époque réalisées au brou de noix sont conservées dans la collection personnelle de l’artiste qui les considère comme véritablement fondatrices de son œuvre et refuse de s’en séparer.
Pierre Soulages, Peinture 202 x 143 cm, 22 novembre 1967
Cette toile est une des plus abouties que Pierre Soulages ait jamais peintes, un vaste champ coloré où domine le noir. La matière qui recouvre la toile, possède des qualités de transparence car, à l’approche de la trouée blanche qui interrompt en bas à gauche le large plan noir, la couche de peinture devient fluide, translucide et laisse transparaitre la lumière du fond préalablement recouvert de marron. Cette couleur brune a été répandue au préalable à la surface de la toile à l’aide d’un outil nouveau, une gouttière, qui apporte à l’artiste en même temps une surface et une forme sur lesquelles il peut ensuite travailler. Au cours des années 1960, l’œuvre de Soulages a tendu vers une plus grande spatialité qui, dès lors, ne fera que s’amplifier. Le coup de brosse inscrit un plan et non plus un signe. La peinture se fait plus monumentale.
Pierre Soulages, Peinture 181 x 244 cm, 25 février 2009, triptyque
Le format adopté ici par l’artiste résulte de trois éléments juxtaposés, trois châssis indépendants qui offrent à la fois des registres de lectures séparées et une vision globale. Soulages a développé ce type de composition à plusieurs éléments à partir de 1984. Cette peinture est caractéristique d’une nouvelle manière de peindre que l’artiste a qualifiée tout d’abord de « noir lumière » puis d’ « outrenoir », un « outrenoir » défini par Soulages comme « au-delà du noir une lumière reflétée, transmutée par le noir ». À partir de 1979, Soulages prend conscience que c’est la texture de la surface, striée ou lisse, qui change la lumière et fait naître des valeurs différentes de mat et de brillant, des noirs gris ou des noirs profonds. Désormais, l’artiste n’est plus guidé par la matière physique de la surface de la toile ni par sa couleur mais par la lumière qui naît au cours de son travail. La toile, entièrement recouverte d’un noir unique, échappe au monochrome : l’outrenoir n’est jamais tout à fait le même selon la position du spectateur et le moment où il regarde la peinture.
En savoir + sur : l'œuvre, l'artiste et la donation
Clémence Sophie de Sermézy (1767-1850), Eudoxie Deschamps de Villeneuve, 1824
Terre cuite, H. 62,5 cm, L. 46,5 cm, P. 20 cm. Achat avec le concours de l’État et de la région Rhône-Alpes dans le cadre du Fonds régional d’acquisition des musées (FRAM) en 2011
Issue d’une famille lyonnaise aisée, Clémence Sophie de Sermézy est l’auteur d’un œuvre sculpté de grande qualité, réalisé sans jamais exposer ni vendre. Longtemps oublié, celui-ci n’a été que récemment redécouvert. Ses travaux, uniquement en terre ou en plâtre, se composent principalement de petits groupes décrivant des scènes de genre ou de bustes de ses proches et de personnalités fréquentant son salon, l’un des plus renommés de Lyon sous l’Empire et la Restauration. Cette œuvre est l’une des plus abouties parmi ses réalisations dans le champ du portrait. Elle représente la jeune épouse de son fils Jean-Baptiste, alors âgée de 18 ans. Elle traduit l’influence du sculpteur Joseph Chinard, auprès de qui Clémence Sophie de Sermézy parfait sa formation à Lyon, sans doute entre 1794-1795 et 1799. L’auteur reprend ici un principe de composition identique à celui de certains de ses bustes, par le choix d’une découpe au niveau de la poitrine et d’une frontalité animée par le désaxement de la tête. Le vêtement très simple évoque les draperies à la grecque, tout en s’accordant au goût du jour. La complexité de la coiffure rappelle également le portrait de Juliette Récamier, dont l’artiste possédait un exemplaire en plâtre. Mais elle se démarque de son maître par la recherche d’un caractère plus décoratif et par l’exploration d’une dimension intime. Cette acquisition vient compléter un ensemble important de 14 œuvres de l’artiste, pour partie données directement au musée par l’artiste ou ses héritiers.
Victor Orsel (1795-1850), Le Bien et le Mal, esquisse, vers 1829
Huile sur toile, H. 60,4 cm, L. 38,8 cm. Achat avec le concours de l’État et de la région Rhône-Alpes dans le cadre du Fonds régional d’acquisition des musées (FRAM) en 2011
Cette esquisse de Victor Orsel pour son tableau manifeste Le Bien et le Mal, conservé dans les collections du musée, n’était plus connue que par une gravure au trait publiée par son biographe Alphonse Périn, jusqu’à sa récente redécouverte. L’artiste conçoit le projet de ce programme iconographique complexe à Rome ; celui-ci lui aurait été inspiré, à en croire son témoignage, par le rêve de la fille d’un ami. L’élaboration en est lente, préparée par de nombreux dessins, puis par cette esquisse peinte. Celle-ci présente plusieurs variantes avec la composition définitive : un ouroboros (serpent qui se mord la queue) remplace en partie supérieure le mot « Aeternitas ». Dans l’écoinçon central sont absents l’alpha et l’oméga. Le costume de l’archange, la position de son épée et celle des bras de la jeune femme qu’il protège diffèrent dans la scène principale. Le tableautin figurant les premiers pas de l’enfant manque également dans la partie supérieure gauche, alors qu’il est transcrit sur la gravure.
Victor Orsel (1795-1850), Sept feuilles d’études pour Le Bien et le Mal, vers 1829
Crayon graphite sur papier. Don de Michel Descours en 2011
De nombreux dessins ont été réalisés par Victor Orsel pour préparer la composition de son tableau Le Bien et le Mal, mais seul l’un d’eux figurait à ce jour dans les collections du musée. Réalisés à Rome, ils révèlent une démarche fidèle à la tradition néo-classique apprise de son maître Pierre Narcisse Guérin. L’artiste débute en effet par l’étude du nu pour mettre en place les attitudes, avant d’habiller ses personnages. C’est ici le cas de la figure du démon sonnant de la trompette, destinée à être placée dans la partie centrale du tableau. Par un jeu de reprise multiple, ces dessins fonctionnent parfois sur un mode sériel jusqu’à parvenir à la solution plastique la plus satisfaisante. Ceux-ci servent à Orsel à mettre en place sa composition dans l’esquisse peinte acquise dans le même temps que cet ensemble par le musée. Plusieurs cartons préparatoires, conservés pour partie au musée du Prado à Madrid, lui permettent ensuite le passage à l’échelle définitive. En raison de ce lent processus, quatre années lui sont nécessaires pour achever cette réalisation, qui sera présentée au Salon de 1833 à Paris, puis à la première édition de celui de la Société des Amis des Arts de Lyon en 1836.
Alexandre Caminade (1789-1862), Le Lévite d’Ephraïm méditant de venger sa femme morte victime de la brutalité des Benjamites, 1837
Huile sur toile, H. 60 cm, L. 81 cm. Don de Clémentine Gustin-Gomez en 2011
Formé parmi la dernière génération des élèves de David, Alexandre Caminade (1789-1862) obtient une solide réputation en tant que portraitiste, ainsi que dans le domaine de la peinture religieuse. Présenté au Salon de 1837, Le Lévite d’Ephraïm est considéré par ses contemporains comme sa meilleure réalisation. Le sujet est tiré du Livre des Juges, dans l’Ancien Testament. Acquis par l’État, ce tableau est déposé au musée Calvet d’Avignon. Plutôt qu’une esquisse, l’œuvre donnée au musée semble être une réduction, fidèle en tous points. Peut-être pourrait-elle être identifiée avec une version exposée au Salon de la Société des Amis des Arts de Lyon en 1839.
Alexandre Caminade (1789-1862), Le Baptême du Christ, esquisse, 1843-1848
Huile sur toile, H. 49,7 cm, L. 60,6 cm. Don de Clémentine Gustin-Gomez en 2011
Le Baptême du Christ, est une esquisse pour une peinture murale réalisée pour la chapelle des fonds baptismaux de l’église Saint-Gervais-Saint-Protais à Paris, dont le décor lui est confié en 1843. L’artiste apparaît dans ces deux réalisations comme fidèle à la tradition classique, revendiquant l’exemple des peintres bolonais et du XVIIe siècle français. Les personnages sont disposés en frise. Les expressions sont retenues et dignes, même pour un sujet dramatique. Les couleurs relèvent d’une harmonie sourde, baignée par une lumière égale.
Hippolyte Flandrin (1809-1864), Jésus-Christ et les petits enfants, esquisse, 1837
Huile sur toile, H. 50 cm, L. 61 cm. Don de Clémentine Gustin-Gomez en 2011
Cette œuvre est la seconde esquisse réalisée par Hippolyte Flandrin pour préparer la composition historique qui constitue son envoi de Rome de cinquième année, tableau aujourd’hui conservé au musée de Lisieux. L’artiste fait le choix d’illustrer un épisode de l’Évangile selon saint Marc. Il débute son travail dès 1836 et s’appuie sur de nombreux dessins, ainsi que sur une première esquisse, conservée au musée départemental de l’Oise à Beauvais, qui organise sa composition dans ses grandes lignes. Plus achevée, celle-ci lui fait suite. Des soucis de santé, puis une épidémie de choléra qui frappe Rome, le retardent toutefois et ce n’est que deux ans plus tard, de retour à Paris, qu’il termine son œuvre, très remarquée au Salon de 1839. L’artiste mêle ici plusieurs sources d’inspirations : il cite des motifs empruntés à Giotto, comme les deux femmes placées de dos au premier plan, et s’inspire d’une composition de même thème de Johann Friedrich Overbeck. Ce ne sont pas cependant ces références qu’il revendique dans sa correspondance, mais celle de Raphaël : il témoigne en effet avoir beaucoup regardé en préparant son tableau ses cartons pour la tenture des Actes des Apôtres. L’ordonnancement frontal des figures, le paysage d’architectures à l’antique et son sens de la couleur renvoient également à Nicolas Poussin. Cette importante esquisse vient compléter un ensemble conséquent d’œuvres de l’artiste dans la collection du musée.
Joseph Guichard (1806-1880), Le Christ en croix entre quatre anges, 1841-1843
Pierre noire, sanguine, craie blanche et pastel sur papier, H. 130 cm, L. 64 cm. Achat en 2011
Originaire de Lyon, Joseph Guichard (1806-1880) se forme à l’école des beaux-arts de sa ville natale, puis à Paris dans l’atelier d’Ingres. Au fil de sa carrière, l’artiste se voit confier plusieurs chantiers de peinture murale et ce domaine devient l’une de ses spécialités. En 1838 lui est ainsi commandé le décor de la chapelle Saint-Landry, située dans le déambulatoire de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris. Parmi cet ensemble, il orne l’autel en pierre, dessiné par Jean-Baptiste Lassus, d’une composition représentant le Christ en croix entre quatre anges recueillant son sang, entouré du roi Clovis II, de saint Landry, sainte Bathilde et Erchinoald, maire du palais. Ce carton, qui conserve des traces de mise au carreau, correspond à la partie centrale de ce retable. Cette réalisation apparaît très marquée par la leçon d’Ingres et témoigne de son apprentissage auprès du maître, dont la légende voudrait pourtant qu’il se soit détourné et qu’il en ait rejeté les principes. Le goût de la ligne et la recherche d’une élégance formelle s’imposent ici et l’éloignent de ses réalisations antérieures comme Rêve d’amour (Lyon, musée des Beaux-Arts), tableau qu’il avait présenté au Salon de 1833 à Paris et qui avait provoqué sa rupture avec Ingres. L’artiste révèle également ici, dans une volonté d’adapter son style au cadre environnant son décor, un regard inédit sur la peinture italienne des XIVe et XVe siècles. Cette œuvre s’inscrit dans une phase méconnue de la carrière de Joseph Guichard, jusqu’ici absente des collections du musée, et permet de compléter l’évocation du renouveau du grand décor religieux au XIXe siècle.
Sébastien Norblin (1796-1884), Allégorie du Jour et des Saisons, 1856
Crayon graphite, aquarelle et gouache sur deux feuilles de papier superposées, H. 68 cm, L. 45 cm. Don de Clémentine Gustin-Gomez en 2011
Lauréat du Grand Prix de Rome en 1825, Sébastien Norblin (1796-1884) mène une carrière de peintre d’histoire sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire. Il demeure durant toute sa vie particulièrement proche des milieux polonais en France, qui plus est après l’échec de l’insurrection de la Pologne en 1830-1831 qui voit affluer une importante émigration à Paris. Il fréquente les cercles politiques et intellectuels en exil, parmi lesquels le salon du prince Adam Jerzy Czartoryski, pour la famille duquel son père avait travaillé. Le prince rachète en 1843 l’Hôtel Lambert, dans l’île Saint-Louis, dont il entreprend la restauration. En 1856, il passe commande à Norblin d’un décor dont la disposition demeure difficile à établir. Seul un recueil de planches gravées en fournit un témoignage et en retrace l’iconographie, celui-ci n’étant plus en place de longue date. Peut-être était-il prévu pour masquer certaines peintures du XVIIe siècle en mauvais état. Ce dessin se présente comme un projet destiné vraisemblablement à être soumis à son commanditaire, par l’usage de deux feuilles de papier superposées présentant des variantes de décor. Cette composition allégorique, associant dans trois registres la Nuit, Apollon et l’Aurore, joue de nombreuses références à l’art du passé, tant à la peinture antique qu’au plafond du casino Rospigliosi de Guido Reni à Rome.